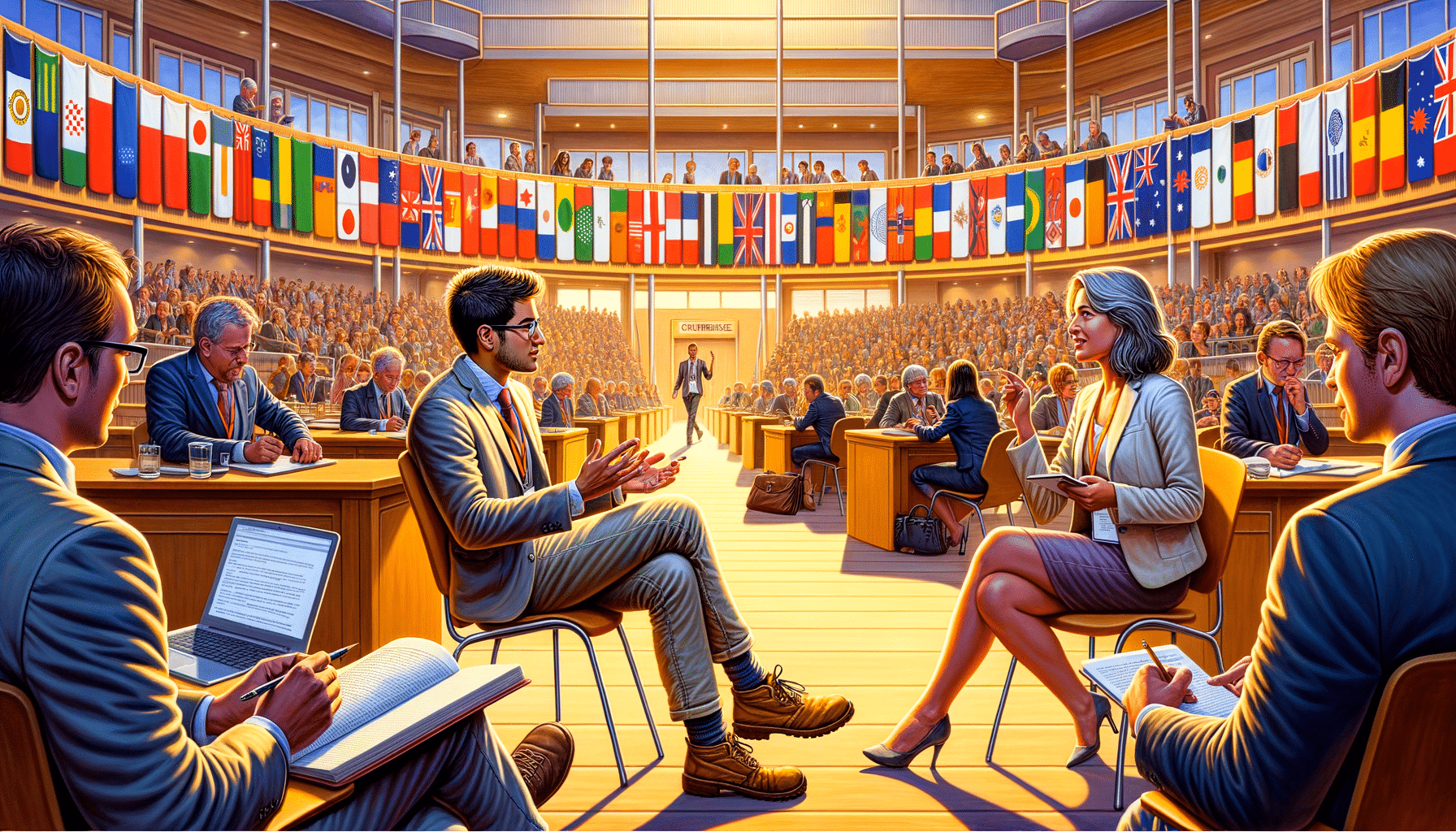Présent à Tahiti à l’occasion du congrès scientifique qui vient de s’y tenir, l’écrivain et anthropologue Serge Tcherkézoff, a présenté en avant-première son dernier ouvrage, Polynésie/Mélanésie, qui tord le cou à bien des idées sur le découpage culturel habituellement admis de la région Pacifique. L’occasion de revenir avec lui sur certains points détaillés par près de 80 des 800 scientifiques réunis dernièrement en congrès.
Directeur d’études à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et directeur du Centre de recherches et de documentation sur l’Océanie (CREDO), Serge Tcherkézoff était l’un des deux animateurs de la session « Culture et politique », l’une des cinq grandes divisions scientifiques proposées lors de l’Inter-congrès des sciences du Pacifique, également séance de travail pour les 2èmes Assises de la recherche française dans le Pacifique.
L’éditeur local « Au Vent des Îles », qui a déjà publié « Tahiti 1768, jeunes filles en pleurs », vient de faire paraître son nouvel ouvrage : « Polynésie/Mélanésie, l’invention française des ‘races’ et des régions de l’Océanie ». Christian Robert a fait venir en avant-première par avion quelques exemplaires de ce livre que l’on trouvera dans les prochaines semaines dans toutes les librairies de Papeete et en métropole. Il a ainsi voulu profiter de la présence du scientifique à Papeete pour l’inviter à participer à une séance de dédicace, samedi matin à la librairie Odyssey, en compagnie de l’ethnologue Bruno Saura, de l’Université de la Polynésie française. Celui-ci y présentait son dernier ouvrage, « Tahiti Ma’ohi » (cf. rubrique « Livres »).
Tahitipresse aura l’occasion de revenir sur cet ouvrage de Tcherkezoff qui propose une histoire générale — et une déconstruction — des visions européennes, raciales et sexistes, sur la nature physique et morale des peuples de l’Océanie, entre les XVIe et XXe siècles.
Avec lui, nous avons voulu revenir sur quelques thèmes, liés à cette problématique, qui ont été abordés lors du colloque.
Tahitipresse : Quel élément saillant est sorti du séminaire que vous animiez, sous la rubrique « Culture et politique »?
Serge Tcherkézoff : « Indiscutablement, le fait qu’on ne peut pas parler de projets de sociétés si l’on fait l’impasse sur les valeurs et les représentations culturelles des populations. Surtout en Océanie, où les questions identitaires sont importantes. Il faut prendre en compte la vision que les gens de telle société ont sur leur environnement ».
Tahitipresse : Qui participait à cette réflexion ?
S. T. : « Outre les participants issus des collectivités françaises du Pacifique, il y avait environ 80 intervenants en provenance d’Etats insulaires du Pacifique, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais également des Japonais et des Américains (Hawaï). Dans toutes ces régions, se posent des questions liées aux relations multiculturelles, à un héritage culturel souvent occulté, déformé ou mal connu… Comme pour l’ensemble du colloque, l’approche était multi et transdisciplinaire. On pouvait aussi bien y trouver des archéologues, des muséographes, des ethnologues, des économistes ou des anthropologues… »
Tahitipresse : Sur quoi peuvent déboucher concrètement de telles rencontres ?
S.T. : « Comme pour les autres disciplines, y compris en biologie ou en climatologie…, s’est imposée la nécessité de renforcer les réseaux d’échanges. Notamment entre les chercheurs francophones et anglophones, entre ce que l’on peut appeler « la franconésie » et « l’anglonésie ». Mais cela est particulièrement vrai pour les sciences humaines et sociales pour lesquelles les concepts doivent pouvoir s’exprimer de façon complémentaire, selon la langue, de manière spontanée. D’ailleurs cela a été bien ressenti par les organisateurs du colloque, puisque nous avons été les seuls à pouvoir disposer d’une traduction simultanée des interventions. Cela nous a aidé, par ailleurs, à regrouper les différentes présentations orales en sous-catégories et, donc, à affiner nos synthèses… »
Tahitipresse : Un bilan positif, en somme…?
S.T.: » Oui, mais à condition que les moyens suivent. Des chercheurs ont fait part de leur inquiétude quant au projet de réforme du système de recherche en France. C’est bien de faire des projets d’avenir, mais il faut des gens pour les mettre en application. Or, l’on assiste à un coup d’arrêt violent sur le budget, le recrutement… »